
Sélectionner une page
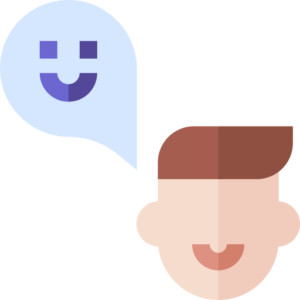
La santé publique est une spécialité transversale, à l’interface entre la médecine, la recherche clinique, l’épidémiologie, l’économie, la politique, la santé internationale, l’informatique médicale, l’environnement, les sciences humaines et sociales, le droit, l’éthique, etc…
Comme son nom l’indique, la santé publique s’intéresse à la santé de toute la population !
Le DES de santé publique a pour objectifs de former des médecins à une approche collective des problèmes de santé, capables d’apporter une expertise médicale aux questions posées en termes de santé des populations et de contribuer à l’argumentation des politiques sanitaires. Les médecins de santé publique utilisent leurs compétences diagnostiques et thérapeutiques dans une approche de prévention individuelle.
Les médecins de santé publique exercent dans des contextes variés : à l’hôpital dans les domaines de la gestion de l’information de santé, de la recherche clinique ou de la gestion de la qualité et de la sécurité des soins ; dans les services de l’Etat, des collectivités territoriales ou de l’assurance maladie ; dans des laboratoires de recherche ; dans les agences nationales ou régionales intervenant dans le champ de la santé ; dans les services de recherche et développement de l’industrie du médicament, des dispositifs médicaux ou des innovations pour la santé ; dans des structures de promotion de la santé ; dans les services orientés vers la prévention des risques individuels et collectifs.
Pour en savoir plus, cette courte vidéo, destinée aux externes en formation (mais aussi aux curieux), vous donne quelques éléments de réponse en moins de 3 minutes.
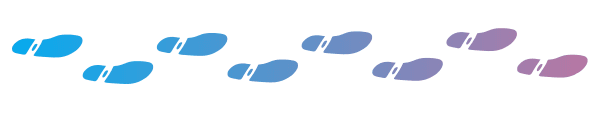
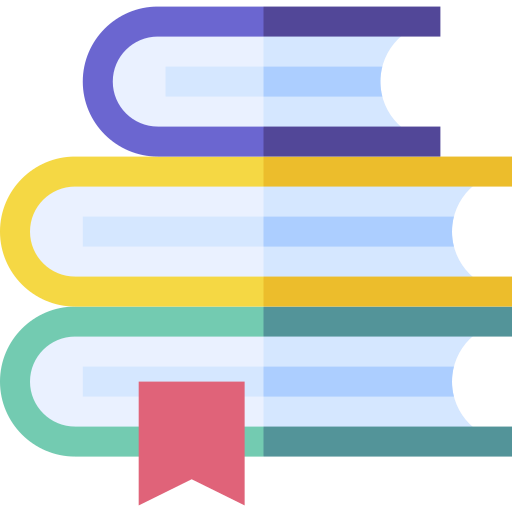
Depuis la réforme du 3ème cycle des études médicales (R3C) entrée en vigueur en 2017, l’internat de santé publique s’organise en 3 phases répartie sur 4 ans :
Les connaissances à acquérir relèvent de 8 modules : (1) biostatistiques ; (2) épidémiologie et méthodes en recherche clinique ; (3) économie de la santé, administration des services de santé, politiques de santé ; (4) promotion de la santé ; (5) Informatique biomédicale et e-santé ; (6) Gestion de la qualité, gestion des risques et de la sécurité des soins ; (7) Sciences Humaines et Sociales ; (8) environnement et santé.
Il est par ailleurs possible de réaliser une formation spécialisée transversale (FST) ou une option pour se spécialiser, en ajoutant une année lors de la phase d’approfondissement.
Vous pouvez télécharger la maquette officielle parue dans le Journal Officiel ici.
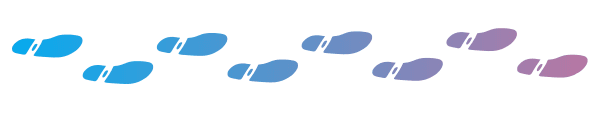

Il est normal, lorsqu’on est extérieur à cette spécialité, d’y voir flou. En étant médecin de santé publique on peut faire énormément de choses. Les champs d’activité sont très variés (recherche, prévention, administration de la santé, politiques de santé, PMSI et j’en passe) tout comme les modes d’exercice (salariés de l’hôpital public, de l’administration, d’agences d’état, salariés dans le privés, dans des ONG, chercheurs, etc…).
Il est donc parfois difficile d’y voir clair dans tout cela. S’il est compliqué d’avoir une vision complète de tous les médecins de santé publique qui exercent en France, on peut s’appuyer sur des données issues de deux enquêtes pour s’en faire une idée :
Il est à noter que même si ces quelques domaines d’activités sont majoritaires, on retrouve des médecins de santé publique exerçant plus où moins partout, que ce soit dans la médecine légale, le handicap, la nutrition, la précarité, les populations déplacées, la gestion documentaire, etc…
La partie offres d’emploi de ce site permet également de se faire une idée des propositions de travail auxquelles nous sommes susceptibles de correspondre, ainsi que des domaines les plus recherchés sur le marché de l’emploi.
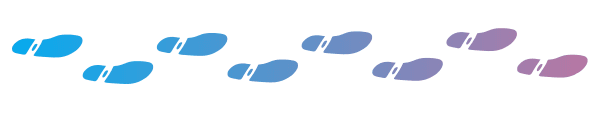
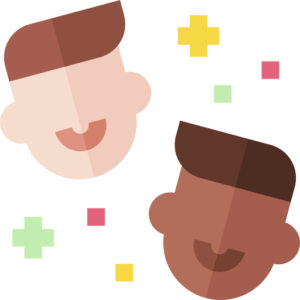
Bien sûr ! Il existe de nombreux témoignages, vidéos, interviews sur la spécialité de santé publique. Ils sont tous rassembler sur la page « Devenir médecin de santé publique » avec notamment :
Par ailleurs, le bulletin du CLISP, publié trois fois par an, contient des entretiens dans lesquels des internes de santé publique ou d’anciens internes de la spé parlent de leur formation, de leur cursus et du métier qu’ils exercent.
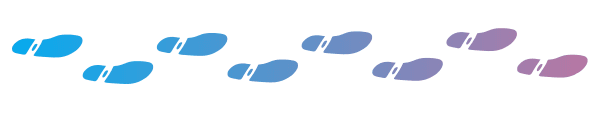
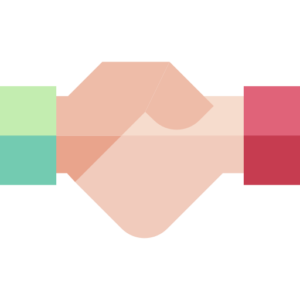
Oui, absolument.
Rien qu’à regarder les offres postées régulièrement sur le site du CLISP, il existe des offres variées dans la plupart des régions de France métropolitaine et d’outre mer ! Du fait de nombre de postes non pourvus chaque année malgré la demande et de la reconnaissance graduelle de l’utilité des médecins de santé publique dans de nombreux domaines de la santé, on assiste à une pénurie des médecins de santé publique en France. Dans l’enquête réalisée en 2018 sur les anciens internes de santé publique en France, plus de 80% des internes avaient trouvé un emploi en moins d’un mois après la fin du DES.
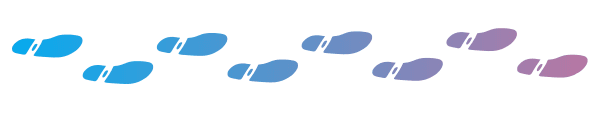
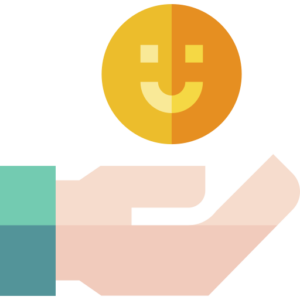
Ils dépendent de l’orientation prise et du travail choisi. Il y a donc une grande variabilité, et le salaire ne sera pas le même que vous travailliez dans une ONG ou pour une industrie pharmaceutique.
Ce que l’on peut dire néanmoins c’est que si vous êtes dans l’hôpital publique (PH ou carrière hospitalo-universitaire), alors vos salaires suivent une grille publique commune avec toutes les autres spécialités. Dans les carrières de l’administration publique aussi, lorsque vous êtes fonctionnaires, ces grilles de salaires sont fixes et publiques. Les salaires sont plus variables (en dessous ou au-dessus des grilles) lorsque vous êtes embauché comme contractuel.
Dans le privé cela va dépendre de votre expérience et de vos talents de négociateurs lors de votre entretien d’embauche !
Vous pouvez avoir une idée des salaires en santé publique via l’enquête réalisée en 2012 auprès des anciens internes.
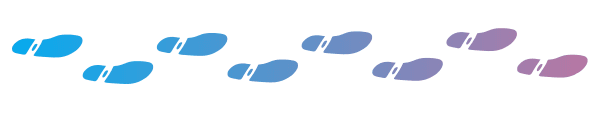
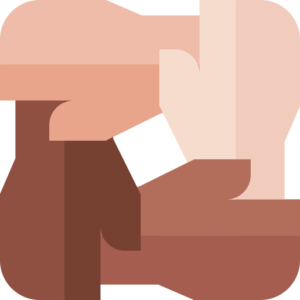
Premièrement, la santé publique s’intéresse à la santé d’un point de vue populationnel. Cela va se traduire par :
L’organisation du travail est elle aussi différente des médecins des autres spécialités. En effet, les journées ne sont pas contraintes par les rendez-vous successifs avec les patients. Cela se traduit par :
Une routine potentiellement moins importante.
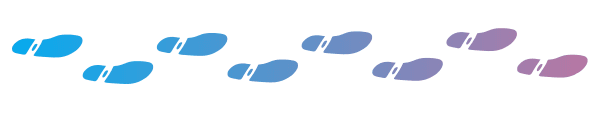
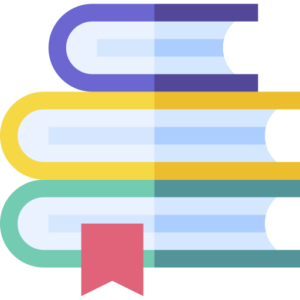
Tout va dépendre de l’orientation choisie au sein de la spécialité. La santé publique c’est très large, les connaissances et compétences varient selon le champ d’action vers lequel on finit par s’orienter :
En fait, il n’y a pas de profil type de compétences à acquérir pendant l’internat. Tout va dépendre de vers quoi tu vas tendre, en fonction des stages vers lesquels tu es naturellement attiré.
Le trio gagnant des compétences universelles à tout médecin de santé publique sont probablement l’esprit d’analyse, de synthèse et de communication. Un médecin de santé publique aime résoudre des problèmes à l’interface entre plusieurs domaines !
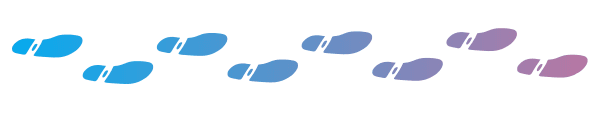
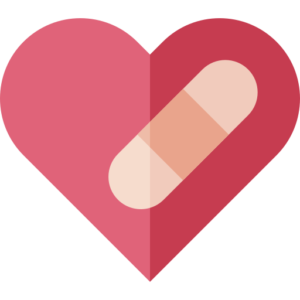
Il y a également durant l’internat la possibilité de faire des stages de clinique dans certaines villes, des stages en hors filières, des Formations Spécialisées Transversales (FST), des Diplômes Universitaires (DU)… ainsi que la possibilité de faire des gardes !
Après l’internat, tu trouveras la possibilité d’exercer comme médecin de CeGIDD, médecin directeur de PMI, médecin scolaire, médecin universitaire, médecin addictologue, praticien conseil de l’assurance maladie, etc…
De plus, les vacations de missions de service public sont une possibilité !
Il y a également durant l’internat la possibilité de faire des stages de clinique dans certaines villes, des stages en hors filières, des Formations Spécialisées Transversales (FST), des Diplômes Universitaires (DU)… ainsi que la possibilité de faire des gardes !
Après l’internat, tu trouveras la possibilité d’exercer comme médecin de CeGIDD, médecin directeur de PMI, médecin scolaire, médecin universitaire, médecin addictologue, praticien conseil de l’assurance maladie, etc…
De plus, les vacations de missions de service public sont une possibilité !
N’hésite pas à consulter les témoignages et les offres d’emploi pour avoir une meilleure idée des possibilités de garder une activité clinique en tant que médecin de santé publique.
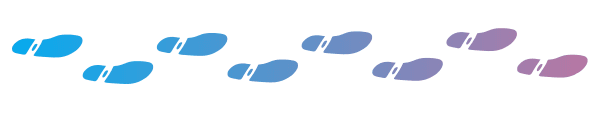
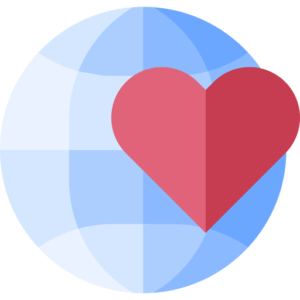
Difficile de répondre sans être chauvin !
Cela va dépendre de tes préférences, des critères que tu juges le plus important : qualité des cours de DES ? Terrains de stage ? Nécessité de faire des gardes ? Masters de qualité ? Météo ?
En effet il y a pas mal de critères à prendre en compte et à pondérer selon ton profil ! De part son histoire et sa culture de la santé publique, chaque ville dispose d’une orientation plus marquée pour certains champs de la SP (ex : Toulouse pour les inégalités sociales de santé, Grenoble pour la santé environnementale, Lille pour l’informatique médicale, Tours pour la promotion de la santé, Paris pour les instances et autorités, Bordeaux avec l’ISPED, Rennes avec l’EHESP, Nancy avec l’école de SP…) . Cependant quelques subdivisions proposent des terrains de stage plus variés que d’autres et sont généralement les plus prisées.
Certaines villes obligent l’interne à faire des gardes, certaines villes proposent des cours, d’autres non. Certaines villes possèdent des masters, d’autres non.
A toi te créer ta propre grille de priorités puis de te manifester auprès des internes référents des villes (dont tu trouveras le contact sur le site de chaque subdivision) ou encore mieux : de te rendre aux apéros-infos proposés durant l’été et se poursuivant parfois jusqu’à la rentrée ! Pour avoir tout le détail des caractéristiques des subdivisions et t’aider à faire ton choix, tu peux te référer à la rubrique « villes » de ce site.
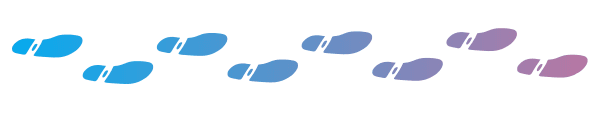

Pour faire simple, la spécialité santé publique souffre d’une vision peu avantageuse dans l’imaginaire populaire des médecins et des étudiants. On peut également constater que le rang moyen à l’ECN des internes qui choisissent directement la santé publique est plus loin que de celui des autres spécialités médicales.
En se penchant sur la question, on peut trouver plusieurs explications à cela :
1) L’absence d’une série américaine sur l’internat de santé publique ?
2) Plus sérieusement, la rareté des Universités qui proposent à leurs externes des stages en santé publique ne permet pas à l’étudiant de susciter des vocations. Dans une spécialité où les projet sont souvent à long terme, il est difficile de concilier la temporalité des stages d’externat (changements tous les 2 ou 3 mois) avec l’exercice complexe des médecin de santé publique.
3) Si tu n’as pas eu l’opportunité (ou la curiosité) d’échanger avec des médecins de santé publique, tu les a probablement rencontré qu’en cours de biostat en P1 ou de réglementation/législation en D4. Et, il faut bien le dire, ce ne sont pas toujours les cours les plus sexy…
4) Les étudiants qui veulent faire cette spécialité n’ont pas la pression de la performance à l’ECN car les postes sont rarement tous pourvus. De fait, ce n’est pas une filière aussi sélective que certaines spés d’organes. La concurrence est moins féroce, ce qui ne te force pas à bachoter juste avant les concours mais te laisse plutôt travailler à ton rythme (intelligemment), sans vouloir finir mieux classés que les autres.
5) Les répartitions des postes d’internes décidées par l’ONDPS ne sont pas toujours affriolantes. Dans certaines villes, comme à Brest, où il n’y a qu’un poste ouvert en 2019 pour zéro interne déjà en poste, cela ne fait pas forcément rêver de tenter l’aventure en solo…
Notons cependant que régulièrement des internes très bien classés aux ECN (top 1000 voire top 100) choisissent la santé publique et contredisent une nouvelle fois les idées toutes faites sur notre spé. Voir par exemple l’interview de l’un de ces internes dans un entretien publié sur egora.fr.
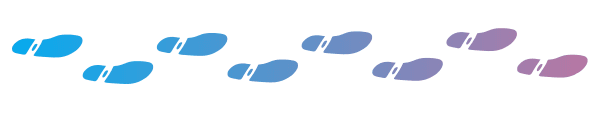
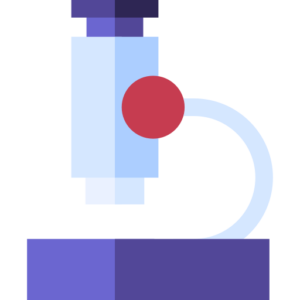
Le master 1 n’est pas considéré comme obligatoire dans les textes de lois. Cependant de nombreux internes suivent un master 1 au début de leur internat ! Le master 1 peut permettre de valider certains des acquis du DES de santé publique. Attention donc à bien se renseigner auprès de l’équipe encadrante (voire “validante”) de ta subdivision DES afin d’être très au clair avec les professeurs qui seront chargés de te valider le jour venu !
Depuis la réforme, différents médecins et professeur en SP ont publié sur la plateforme SIDES-NG des cours sous forme de vidéos sur tout le programme du DES de Santé Publique. Même si actuellement la qualité et la régularité de parution peuvent être variables, ces cours doivent permettre de couvrir les acquis nécessaires au DES de santé publique.
Un master 2 est actuellement l’un des moyens permettant aux internes de se spécialiser dans un domaine. Dans une étude sur les anciens internes de SP réalisée en 2018, nous retrouvons que 88% des ISP sont détenteurs d’au moins un M2. Il existe aussi des masters 2 dits “de recherche” qui ont l’objectif de réaliser un travail scientifique original et qui peut être un premier pas vers une thèse scientifique.
Pour chercher les masters 2 proposés dans chaque division, c’est par ici.
Depuis la réforme, les internes ont la possibilité de réaliser une option ou une Formation Spécifique Transversale. Rajoutant un an supplémentaire à l’internat, elles ont pour objectifs de remplacer, à terme, le suivi d’un master durant le DES.
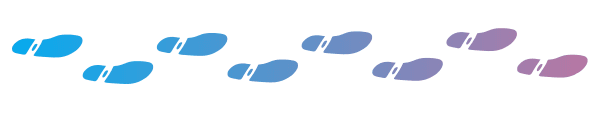
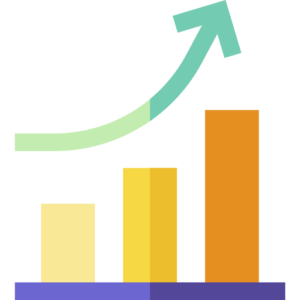
Pas du tout !
La formation de l’interne suit une croissance (exponentielle) tout au long de l’internat. Il n’est pas nécessaire de se former avant la prise de fonction mais libre à toi de cultiver ta curiosité en feuilletant les onglets de la rubrique “Ressource” et les articles d’ISP dans les Bulletins ou encore en suivant les Actualités via notre NL…
Beaucoup de ressources différentes te seront utiles pour maîtriser les diverses compétences dont relèvent les internes de santé publique : les cours de DES, les cours sur la plateforme SIDES, les MOOC, les masters, les suivis de travaux (thèses) d’autres internes, l’apprentissage sur le terrain en stage ou encore dans des missions associatives…
A noter que selon leurs profils et orientations, certains internes mobilisent pas ou peu de compétences statistiques mais développent d’autres compétences (par exemple en sciences humaines et sociales).
Pas besoin donc de passer son (meilleur) été à réviser les biais épidémiologiques ou lois de Student !
D’ici là, si tu as besoin d’aide pour préparer les EDN, n’hésite pas à consulter les ressources utiles en santé publique pour bien se préparer au concours.