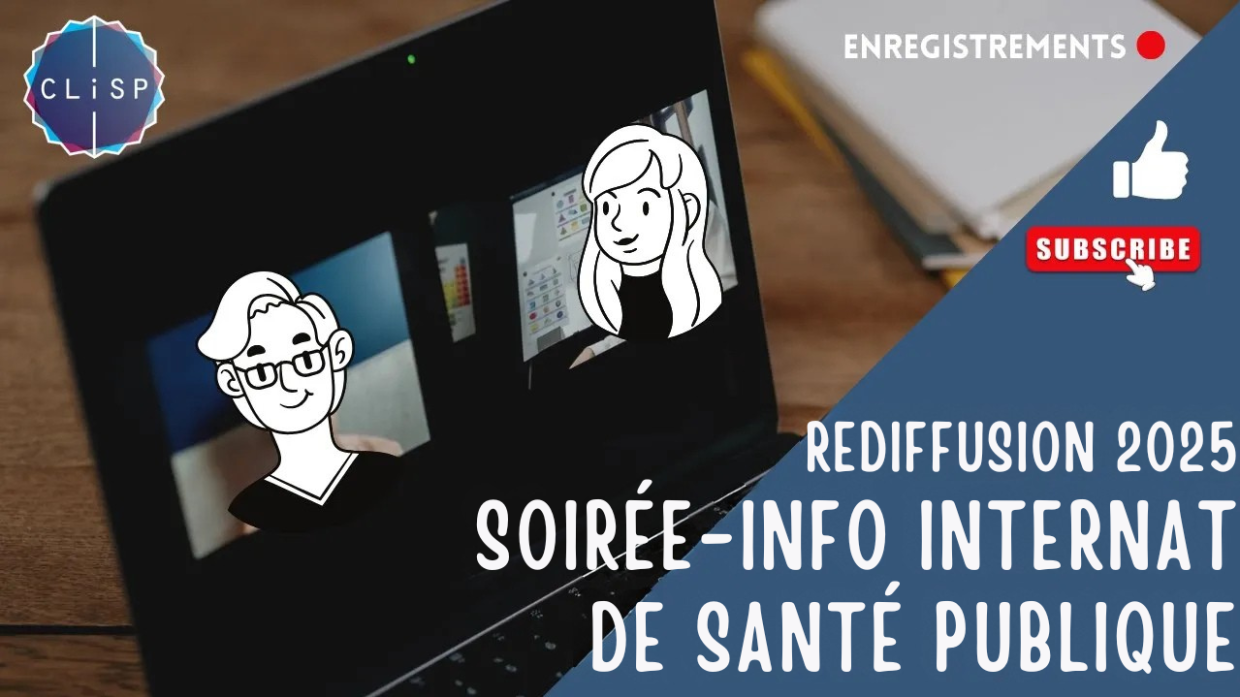Haut fonctionnaire, médecin de santé publique, Françoise Schaetzel est également conseillère municipale à la ville de Strasbourg et conseillère de l’Eurométropole déléguée « au suivi de la qualité de l’air ». Elle accepte pour nous de revenir sur quelques aspects de son (vaste) parcours professionnel.
Haut fonctionnaire, médecin de santé publique, Françoise Schaetzel est également conseillère municipale à la ville de Strasbourg et conseillère de l’Eurométropole déléguée « au suivi de la qualité de l’air ». Elle accepte pour nous de revenir sur quelques aspects de son (vaste) parcours professionnel.
S.G. : Bonjour Madame. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
F.S. : Je suis actuellement dans la haute fonction publique d’Etat, chargée d’évaluation de politiques de santé et cela depuis maintenant 10 ans. Mon activité professionnelle initiale est celle de la médecine générale : j’ai exercé plusieurs années dans un quartier sensible de Strasbourg. Cette expérience de terrain a fait de moi une militante convaincue de la médecine de premier recours. Plus tard, devenue médecin inspecteur de santé publique (MISP), j’ai occupé plusieurs postes en administration de la santé, réalisant nombre d’allers-retours entre DDASS et DRASS. J’ai par la suite rejoint une direction interministérielle en charge des questions santé et pauvreté. Plusieurs années enseignante à l’Ecole nationale de santé publique (devenue désormais l’Ecole des hautes études en santé publique, EHESP, ndlr.), j’ai beaucoup travaillé sur l’évaluation des politiques de santé et c’est sans doute en partie pourquoi je me sens bien dans ma fonction actuelle.
S.G. : C’est là un questionnement récurrent des internes de santé publique que le choix (ou non) du saut statutaire. Quelles opportunités vous a apporté le statut de MISP ?
F.S. : J’ai rejoint le corps des MISP dans les années 1980. Dans une administration où la créativité et l’innovation étaient possibles, j’ai contribué à créer les premières conférences régionales de santé, qui contribuaient à introduire une démocratie sanitaire dans la définition et la mise en œuvre des politiques régionales de la santé. Mon double regard, de professionnel médical et de professionnel de santé publique, m’a toujours permis d’appréhender les sujets avec le souci du décloisonnement. C’est ainsi que j’ai pu mettre en place des programmes de santé intégrés portant tout à la fois sur la prévention, le soin, la réadaptation ou les soins palliatifs.
S.G. : Vous êtes désormais élue à Strasbourg et en charge du suivi de la qualité de l’air sur la métropole. Cet engagement politique n’est-il pas une preuve que le plaidoyer auprès des décideurs a ses limites ?
F.S. : Je ne le crois pas, au contraire. D’abord je tiens à préciser que je cloisonne entièrement entre mes deux casquettes. Je dispose d’une décharge pour exercice d’un mandat électif comme la loi le permet et je ne m’exprime jamais, lorsque je suis dans la métropole, en tant que fonctionnaire d’Etat mais exclusivement en tant qu’élue. Sur les questions relatives à l’organisation des soins, je veille à ne pas intervenir. Maintenant concernant le plaidoyer, je pense qu’au contraire disposer des deux casquettes peut être un avantage. Le fait qu’il y ait un élu qui soit médecin et a fortiori professionnel de santé publique est un facilitateur pour faire avancer les politiques de santé au niveau des territoires. Les données probantes sur ce point ne manquent pas. Par exemple, l’Inserm a pu montrer que la présence d’élus médecins améliorait l’implémentation et les résultats de programmes portant sur la réduction des risques. En santé publique, le contexte dans lequel se déploie une intervention est fondamental. L’étude des éléments facilitateurs et des freins permet d’ailleurs de renseigner les acteurs sur la transférabilité de ces interventions. Concrètement, ma position d’élue me permet de plaider efficacement auprès de mes collègues à la métropole.
 S.G. : Les Agences régionales de santé (ARS) ne sont-elles pas un maillon important de ce plaidoyer ?
S.G. : Les Agences régionales de santé (ARS) ne sont-elles pas un maillon important de ce plaidoyer ?
F.S. : Bien entendu mais l’ARS n’est pas forcément la mieux placée pour le faire directement. Au-delà des manques de ressources, l’enjeu est aussi de se faire comprendre des acteurs du territoire. Les agences ont leur propre vocabulaire et ne parlent pas forcément le même langage que les acteurs de terrain. En revanche, il faut qu’elles capitalisent sur les méthodologies dont elles disposent et sur le rôle d’appui qu’elles peuvent prendre. Il peut par contre sembler plus difficile qu’elles agissent en direct auprès des élus, leur objectif pourrait être au contraire d’identifier les alliés locaux. Revient alors à ceux-ci de se mettre, comme le dit Pierre Lascoumes, en “position de transcodage” afin de traduire les demandes auprès de leurs collègues.
S.G. : Ce rôle d’interface est une constante du médecin de santé publique. Comment cela se manifeste dans votre quotidien ?
F.S. : Je me retrouve dans cette situation à plusieurs niveaux. D’abord avec la population, ensuite avec les services territoriaux, puis avec les collègues élus et enfin avec les partenaires institutionnels.
S’agissant de mon dialogue avec les citoyens, en ma qualité de chargée de la qualité de l’air à la métropole strasbourgeoise, j’ai voulu faire émerger un lobby associatif actif sur cette thématique. Cela permet de structurer la parole et qu’elle soit audible. Le fait d’être médecin de santé publique a été, une fois encore, un atout : notre rôle consiste à faire émerger le collectif dans une problématique qui, a priori, n’est pas encore abordée sous l’angle populationnel.
Auprès des services territoriaux, en revanche, mon expérience professionnelle peut constituer une limite. Mon passé de chef de projet et mes compétences en management ont pu me conduire parfois à m’imposer avec excès, à faire preuve de dirigisme, alors même que les agents territoriaux aiment agir avec souplesse sur ces sujets. Pour autant, ils apprécient notre expertise. Il faut juste apprendre à trouver sa place. Une difficulté dans l’administration territoriale (comme ailleurs) est souvent celle du cloisonnement.
Avec les élus, le fait d’être médecin est clairement un plus. Il permet de crédibiliser la parole. L’enjeu est alors, vous l’aurez compris, de diffuser les bons messages avec le plus d’efficacité. Il faut pour cela être capable de parler aux élus influents.
S.G. : Vous parlez du cloisonnement des services de l’administration territoriale. Comment faire entendre la question de la santé, particulièrement transversale, dans ce contexte ?
F.S. : Une des premières choses que j’ai pu identifier concernant la qualité de l’air était qu’il fallait être en mesure de développer un “réflexe air” dans nos politiques publiques locales, une certaine automaticité à penser “qualité de l’air”. Cela se traduit par l’émergence de la problématique chaque fois qu’il est question d’un projet d’urbanisme, d’énergie ou de transport par exemple. L’élaboration d’un nouveau quartier doit ainsi obliger toutes les parties prenantes à se poser des questions sur la qualité de l’air. En santé publique on n’est jamais tout seul et on ne peut rien faire seul. La reconquête sur ces questions passe par la transversalité et le concept de santé dans toutes les politiques.
S.G. : Nous revenons justement d’un séminaire national de formation à Nantes qui a porté sur la santé en milieu urbain (Urban Health). Il a notamment été question de la nécessité de penser un urbanisme promoteur de santé. Vous retrouvez-vous dans ce constat ?
F.S. : Oui même si, en la matière, je préfère parler d’urbanisme porteur de qualité de vie. C’est là encore une façon de parler le discours des décideurs et des acteurs de terrain pour lesquels la santé se réduit trop souvent aux soins ou à l’éducation pour la santé. Adopter un vocabulaire compréhensible pour la population est essentiel. Voilà pourquoi il vaut mieux parler de bien-être ou mieux : de qualité de vie. A ce moment là, toutes les politiques débattues au niveau d’une métropole comme d’une ville peuvent se préoccuper de la qualité de vie des habitants, qu’on relie systématiquement avec le cadre de vie, l’attractivité d’un territoire, l’enjeu économique…
 S.G. : Certains dispositifs sont porteurs de cette idée de santé dans toutes les politiques. C’est notamment le cas des évaluations d’impact sur la santé (EIS). Que pensez-vous de cet outil ?
S.G. : Certains dispositifs sont porteurs de cette idée de santé dans toutes les politiques. C’est notamment le cas des évaluations d’impact sur la santé (EIS). Que pensez-vous de cet outil ?
F.S. : Il faut impérativement que ces EIS puissent cibler les différents sous groupes de population pour qu’elles conservent leur approche historiquement tournée vers les inégalités sociales de santé. Sur la métropole nous sommes en train de mener une EIS de ce type qui porte sur des déterminants de l’environnement : la pollution, l’air, le bruit, le sol ou encore la cohésion sociale. Nous avons fait appel à une équipe de l’EHESP pour la mener. Les premiers résultats sont intéressants. De la même façon que l’évaluation des politiques publiques (EPP), l’EIS donne des résultats en tant que processus même. Le simple fait d’avoir déclenché une EIS sur la métropole a permis une longue délibération (près d’une heure ce qui est très rare) sur l’urbanisme porteur de qualité de vie lors du conseil municipal. De même, le séminaire réalisé avec la population a fait émerger des attentes sur les soins primaires. Cela se traduira notamment par la création d’une maison de santé pluri-professionnelle (MSP). Cela n’aurait sans doute pas pu être possible sans cette opportunité de donner la parole aux usagers qu’offre l’EIS.
S.G. : On voit qu’il est difficile pour les collectivités de disposer de ressources en propre dans ces domaines et que les EIS sont souvent externalisées. L’enjeu n’est-il pas vers le développement d’une culture de l’EIS ?
F.S. : Je le pense en effet. Il pourrait être judicieux de faire appel à ces mêmes équipes de recherche pour former directement à l’EIS et faire en sorte de pérenniser le message que porte ce type d’évaluation. Cela permettrait d’aborder les politiques locales différemment. Un autre enjeu est ensuite celui de la valorisation de résultats tangibles. Cela s’avère nécessaire pour que la greffe prenne et que la transférabilité puisse s’opérer.
S.G. : Pour finir, que pensez-vous des contrats locaux de santé (CLS) ?
F.S. : Ils font partis de ces outils ciblés “santé” portés par l’ARS. Les villes peuvent s’en saisir et ce sont des outils formidables. J’ai l’habitude de dire que le CLS n’est pas du contenu mais du contenant. On peut y mettre quasiment ce que l’on veut pour peu que la négociation avec l’ARS l’autorise. Cela peut se faire à l’échelle d’une ville, d’une métropole ou d’une intercommunalité. C’est un cadre de concertation important. Sur Strasbourg, nous disposons, par exemple, de 14 partenaires dans le CLS. Là encore, c’est un authentique dispositif de santé publique.
Propos recueillis par Sylvain Gautier, ISP de Paris